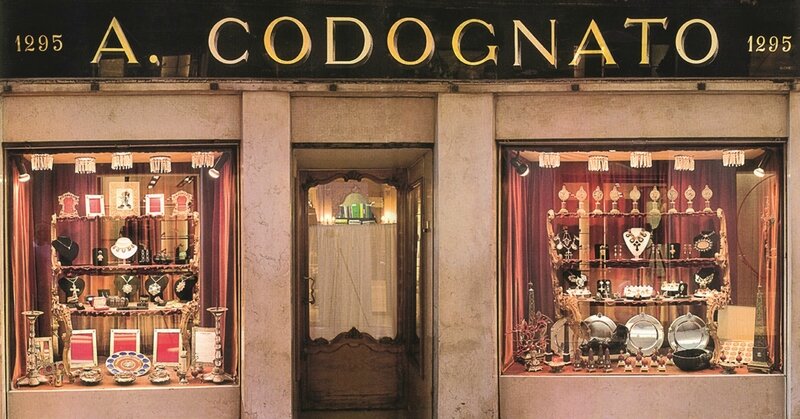Extrait de cet article de Mario Asselin:
Au Québec, le fossé se creuse en effet. Pour cinq femmes qui entrent à l’université, deux obtiennent un baccalauréat universitaire, alors que c’est le cas pour un homme sur quatre, seulement (source).
Au secondaire, on parle d’un garçon sur cinq qui sort sans aucun diplôme (21,5% des garçons), peu importe le nombre d’années passées sur les bancs d’école, alors que c’est le cas pour 13,6% des filles (source).
Joseph Facal a raison d’insister sur les problèmes en lecture des garçons: «C’est surtout en lecture que l’avance des filles est frappante».
Voilà pourquoi l’Ontario s’est attaqué de front au problème en 2009, en adoptant la stratégie «Moi, lire? Et comment!» qui visait à développer les compétences des garçons en matière de littératie.
Parmi les volets les plus porteurs des actions mises de l’avant, on a aidé les enseignants à choisir des ressources adaptées aux garçons, on leur a fourni plus souvent des occasions de lire et d’écrire sur des sujets qui les allument, on a maximisé l’utilisation du numérique et on a surtout lutté contre l’idée reçue chez les garçons que «la lecture serait un passe-temps pour filles».
Mais pour pouvoir agir au Québec, il faudra commencer par admettre que l’école primaire et secondaire ne propose souvent que des modèles féminins aux garçons.
Il suffit d’écouter et de lire ce que les syndicats d’enseignement, le Conseil du statut de la femme et plusieurs groupes féministes véhiculent: adopter des stratégies différentes pour approcher les garçons et les filles en matière de littératie, ce serait «encourager les stéréotypes sexuels»!
En éducation, on est encore pris dans ce débat que sous prétexte d’égalité, il faut faire lire les mêmes livres à tous et proposer les mêmes sujets d’écriture pour éviter tout stéréotype à l’école.
(...) «Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas réaliser que les écoles sont souvent bien mal adaptées à l’énergie et aux centres d’intérêt des garçons», affirme Égide Royer (professeur en adaptation scolaire à l’Université Laval), le plus souvent qu’il le peut (source).
Au Québec, le fossé se creuse en effet. Pour cinq femmes qui entrent à l’université, deux obtiennent un baccalauréat universitaire, alors que c’est le cas pour un homme sur quatre, seulement (source).
Au secondaire, on parle d’un garçon sur cinq qui sort sans aucun diplôme (21,5% des garçons), peu importe le nombre d’années passées sur les bancs d’école, alors que c’est le cas pour 13,6% des filles (source).
Joseph Facal a raison d’insister sur les problèmes en lecture des garçons: «C’est surtout en lecture que l’avance des filles est frappante».
Voilà pourquoi l’Ontario s’est attaqué de front au problème en 2009, en adoptant la stratégie «Moi, lire? Et comment!» qui visait à développer les compétences des garçons en matière de littératie.
Parmi les volets les plus porteurs des actions mises de l’avant, on a aidé les enseignants à choisir des ressources adaptées aux garçons, on leur a fourni plus souvent des occasions de lire et d’écrire sur des sujets qui les allument, on a maximisé l’utilisation du numérique et on a surtout lutté contre l’idée reçue chez les garçons que «la lecture serait un passe-temps pour filles».
Mais pour pouvoir agir au Québec, il faudra commencer par admettre que l’école primaire et secondaire ne propose souvent que des modèles féminins aux garçons.
Il suffit d’écouter et de lire ce que les syndicats d’enseignement, le Conseil du statut de la femme et plusieurs groupes féministes véhiculent: adopter des stratégies différentes pour approcher les garçons et les filles en matière de littératie, ce serait «encourager les stéréotypes sexuels»!
En éducation, on est encore pris dans ce débat que sous prétexte d’égalité, il faut faire lire les mêmes livres à tous et proposer les mêmes sujets d’écriture pour éviter tout stéréotype à l’école.
(...) «Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas réaliser que les écoles sont souvent bien mal adaptées à l’énergie et aux centres d’intérêt des garçons», affirme Égide Royer (professeur en adaptation scolaire à l’Université Laval), le plus souvent qu’il le peut (source).